 Si les méchantes sont toujours des femmes fortes, les méchants sont au contraire le plus souvent des hommes faibles. Pas au sens où ils seraient moins redoutables que leurs homologues féminines, mais au sens où ils ne correspondent pas à la norme sexiste qui veut que les hommes soient virils et puissants. En effet, ils sont la plupart du temps efféminés et ne recherchent pas le combat frontal avec le héros.
Si les méchantes sont toujours des femmes fortes, les méchants sont au contraire le plus souvent des hommes faibles. Pas au sens où ils seraient moins redoutables que leurs homologues féminines, mais au sens où ils ne correspondent pas à la norme sexiste qui veut que les hommes soient virils et puissants. En effet, ils sont la plupart du temps efféminés et ne recherchent pas le combat frontal avec le héros.
Comme on le verra, il existe quelques exceptions à cette règle. Le méchant est alors moins caractérisé par rapport à son sexe qu’en fonction de son appartenance ethnique et/ou de classe. Le racisme et/ou le classisme prennent alors (apparemment) le dessus sur le sexisme. Sauf que ce dernier reste tout de même « primo-structurant », puisque c’est justement parce qu’ils sont des hommes que ces méchants peuvent être caractérisés par autre chose que par leur sexe. Comme on l’a vu, aucune des méchantes (et aucune des femmes en général sous le patriarcat) n’échappe à son sexe. Alors que les hommes, en tant que dominants, passent pour le « genre universel », et n’ont de « particularité » que s’ils appartiennent à une ethnie ou une classe dominée. Cela posé, nous examinerons d’abord les méchants constituant des écarts par rapport à la norme sexiste, puis ceux pour lesquels le « problème » réside plus dans leur appartenance ethnique et/ou de classe.
Pour mémoire, les méchants les plus fameux des « classiques d’animation Disney » sont : Grand Coquin et Stromboli dans Pinocchio, le Capitaine Crochet dans Peter Pan, Shere Khan et Kaa dans Le livre de la jungle, Edgar dans Les Aristochats, Prince Jean dans Robin des Bois, Professeur Ratigan dans Basil, détective privé, Gaston dans La belle et la bête, Jafar dans Aladdin, Scar dans Le Roi lion, Ratcliffe dans Pocahontas, Frollo dans Le bossu de Notre-Dame, Hadès dans Hercule, Shan Yu dans Mulan, Clayton dans Tarzan, et le Dr Facilier dans La Princesse et la grenouille.
Une bande d’efféminés
D’un point de vue purement physique, on peut d’abord remarquer que les méchants ne sont pas aussi athlétiques et virils que les héros auxquels ils sont confrontés. Il n’y a qu’à comparer Jafar à Aladdin, Scar à Mufasa/Simba, ou encore Frollo à Quasimodo pour se rendre compte du fossé qui sépare les gentils des méchants. Ces derniers tendent souvent à être soit squelettiques (Jafar, Scar, Frollo, Facilier), soit obèses (Ratigan, Ratcliffe). Dans tous les cas, ils ne possèdent ni les proportions parfaites des héros, ni leur agilité et/ou leur puissance dans l’action[1]. Pour Disney, un homme faible physiquement est nécessairement malade, donc mauvais. A quoi s’ajoute qu’il n’a par conséquent pas la carrure pour exercer le pouvoir. C’est par exemple flagrant dans le cas de Prince Jean, qui nage de manière ridicule dans ses habits royaux.
 Prince Jean sur un trône beaucoup trop grand pour lui
Prince Jean sur un trône beaucoup trop grand pour lui
On retrouve la même idée chez le personnage de Scar dans Le Roi Lion. La scène de son introduction est fondée sur l’opposition entre son physique maladif et celui, sain et robuste, de son frère Mufasa. Le premier est anguleux et squelettique, tandis que le second est rond et bien proportionné.
On peut également noter que les griffes de Scar sont apparentes, contrairement à celles de Mufasa (on retrouve la même opposition dans le Livre de la jungle entre les immenses griffes de Shere Khan et celles, invisibles, de Bagheera).
Cela renvoie à un signe caractéristique des méchants chez Disney : ils ont souvent des mains fines et des doigts longs (voire crochus). Il suffit de penser par exemple au Dr Facilier dans La Princesse et la grenouille, à Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame, ou à Jafar dans Aladdin. Avec l’absence de muscles, ces mains féminines sont ainsi un autre trait par lesquels les méchants sont dévirilisés.
 Jafar et ses mains de gonzesse
Jafar et ses mains de gonzesse
On pourrait aussi parler de la taille de la moustache, autre détail récurrent par lequel Disney nous informe sur le type de masculinité à laquelle nous avons affaire. Si la grosse moustache est l’apanage des hommes gentils et bienveillants (le plus souvent des pères, comme celui de Jasmine dans Aladdin, celui de Jane dans Tarzan, ou celui de Belle dans La Belle et la bête), la moustache fine est au contraire un signe de fourberie et de méchanceté. En effet, quoi de plus suspect que ce raffinement et cette attention toute féminine à son physique…




 Montre-moi ta moustache, je te dirai qui tu es
Montre-moi ta moustache, je te dirai qui tu es
Ce raffinement suspect s’exprime d’ailleurs aussi dans les choix vestimentaires des méchants, dont la frivolité tranche avec la sobriété de ceux des héros. C’est par exemple le Dr Facilier et son tee-shirt moulant et trop court, le Capitaine Crochet et ses frou-frous, ou encore Ratcliffe et ses couettes[2].
Mais c’est surtout dans leur manière de bouger et de parler que les méchants sont les plus féminins. Leur voix va régulièrement s’aventurer dangereusement du côté des aigus, tandis que leur façon de s’exprimer est parfois assez soutenue et maniérée (Scar, Shere Khan, ou Edgar par exemple). Leurs poses et leurs mouvements sont par ailleurs souvent connotés comme féminins. Il n’y a qu’à observer Scar pour s’en convaincre.
Parfois, les méchants vont même jusqu’à se livrer à un numéro de danse totalement inenvisageable pour un héros viril tellement il emprunte aux codes de l’« érotisme féminin ». C’est manifeste par exemple chez Scar, qui roule des épaules, passe sensuellement sa main dans sa longue chevelure, et sautille sur la pointe des pieds, mais aussi chez Ratigan qui multiplie les pointes et n’hésite pas à se lancer dans un émouvant solo à la harpe (comme Duchesse dans Les Aristochats).
En résumé, ces méchants ne sont au final qu’une bande d’efféminés. Tout est fait pour signifier aux spectateurs/trices leur non-conformité aux normes de virilité incarnées par les héros.
Mais comme on l’a dit, certains méchants échappent à cette caractérisation en termes de masculinité déficiente. Par exemple, Gaston dans La belle et la bête ou Shan Yu dans Mulan semblent réaliser parfaitement l’idéal viril imposé aux hommes dans notre société patriarcale. Et pourtant ce sont des méchants. Cet apparente contradiction s’explique néanmoins assez rapidement lorsque l’on comprend qu’ils se caractérisent plus par rapport à leur classe et à leur ethnie que par rapport à leur sexe.
Bouseux, ploucs et usurpateurs
Le personnage de Gaston dans La belle et la bête est un exemple particulièrement éclatant du classisme véhiculé par Disney dans la caractérisation de ses méchants. Gaston est la star de son village. Tous les hommes l’envient et toutes les femmes sont folles de lui.
Comme le dit la chanson : « Le plus beau, c’est Gaston. Le plus costaud, c’est Gaston. Et personne n’a un cou de taureau comme Gaston / Le plus fort, c’est Gaston. Le plus sport, c’est Gaston. Quand tu le mets sur un ring, personne mord comme Gaston ! / etc. ». Et les dessinateurs n’y vont pas par le dos de la cuillère :


 « C’est toi le champion, Gaston ! »
« C’est toi le champion, Gaston ! »
Et pourtant, Gaston est un méchant. Mieux, c’est un horrible « macho ». Il déclare par exemple à Belle : « Les femmes ne sont pas faites pour lire. Dès qu’elles ont des idées dans la tête, c’est l’horreur ». Disney semble donc dénoncer ici le sexisme de base qui cherche à réduire les femmes à leur seul physique en leur refusant ainsi l’accès au savoir et à la culture. Le message semble d’autant plus clair que ce discours est mis dans la bouche d’un personnage particulièrement viril et dominateur. Le studio serait-il devenu féministe ? Aurait-il enfin déclaré la guerre au sexisme après plusieurs décennies passées à son service ?
Malheureusement non, comme on pouvait s’en douter… Car si Gaston est sexiste, si c’est un « macho », c’est avant tout parce que c’est un bouseux, un plouc. Lorsque Belle lui dit qu’il est un « analphabète basique et primaire », il répond (au premier degré) : « Merci du compliment ». L’héroïne en parlera à son père comme d’un individu « grossier, ordinaire, sûr de lui ». Et après l’avoir renvoyé alors qu’il venait la demander en mariage, elle s’exclamera : « Vous vous rendez compte ? Oser me demander d’être sa femme… moi, devenir l’épouse de ce rustre, de ce primaire… ». Plus globalement, c’est le village entier qui est présenté comme un peuple de bouseux incultes aux spectateurs/trices. C’est tout le propos de la chanson inaugurale de Belle, qui dit vouloir « vivre autre chose que cette vie ». Lorsqu’elle tente de parler au boulanger du livre qu’elle vient de dévorer, celui-ci ne l’écoute pas et préfère crier sur sa femme. Tout le monde la trouve étrange et elle-même confie à son père : « J’ai l’impression que je suis différente des autres et je ne peux discuter avec personne ». Dans sa chanson, elle déclare vouloir « tout ce qu’elle n’a pas : un ami qui la comprenne, des livres par centaines, sans s’occuper des gens qui jacassent ». Le choix d’un vocabulaire animalier n’est pas un hasard. Les habitant-e-s de ce village sont en effet plusieurs fois comparé-e-s à des bêtes dans le film, comme pour signifier de manière bien explicite leur sous-humanité.

 Moutons ou cochons, les bouseux n’y comprennent vraiment rien
Moutons ou cochons, les bouseux n’y comprennent vraiment rien
Mais le plus bouseux d’entre tou-te-s reste quand même Gaston. Lui qui n’a pas dû ouvrir un seul livre de sa vie, et qui n’en comprend en tout cas pas la valeur puisqu’il pose sans complexe sur eux ses bottes pleines de boue.
En concentrant tout le sexisme dans le personnage de Gaston, Disney insinue donc que ce mal ne touche que les gens de basse extraction, les incultes qui ne lisent pas et restent donc dans un obscurantisme moyenâgeux. Sous-entendu : pas de sexisme chez nous, mais seulement chez les « Autres ». Or, n’en déplaise aux membres de la classe dominante, le sexisme (comme le racisme d’ailleurs) n’est pas l’apanage des « pauvres gens », mais il est au contraire de ce point de vue la chose du monde la mieux partagée… Disney se livre donc ici à une dénégation massive qui sera parachevée dans le film avec le portrait complaisant du personnage de la Bête. En effet, malgré son appartenance à la classe supérieure, celui-ci est tout de même odieux avec Belle. Mais le film refusera jusqu’au bout de faire le lien entre ce comportement violent et dominateur envers les femmes et un quelconque système patriarcal. En effet, contrairement à Gaston qui est juste un « macho » inculte, la Bête est la victime tragique d’une terrible malédiction, un être complexe et tourmenté qui, sous son apparence rustre et sauvage, cache un cœur plein d’amour… Dans cette différence de traitement des deux personnages masculins apparaît ainsi en pleine lumière tout le classisme de Disney.
Gaston est un bouseux, c’est entendu. Mais cela suffit-il pour faire de lui un méchant ? Apparemment non, puisqu’il existe chez Disney un grand nombre de personnages n’appartenant pas à la classe dominante et qui sont néanmoins représentés positivement, comme faisant partie des gentils. C’est par exemple le cas de Robin des Bois et ses amis, de Mulan ou encore de Tania dans La princesse et la grenouille. Donc le tort de Gaston au final, ce n’est pas juste d’être un bouseux. Son tort, c’est peut-être alors de vouloir être plus que cela, de se prendre pour ce qu’il n’est pas.
En effet, chez Disney, chacun-e a une place bien déterminée dans l’ordre social. Les pauvres doivent rester pauvres car c’est dans leur nature de pauvres, et les riches rester riches car c’est dans leur nature de riches. Par exemple, dans Robin des bois, le héros et ses ami-e-s ne remettent en question l’ordre établi que pour faire revenir au pouvoir le bon roi (Richard Cœur de Lion) auquel le mauvais roi (Prince Jean) avait tenté de se substituer. Les dominé-e-s n’aspirent donc qu’à une place de dominé-e-s moins douloureuse, mais jamais à sortir du rapport de domination qu’ils/elles subissent. De même, dans Oliver et compagnie, les ami-e-s d’Oliver retournent à la fin tout naturellement dans les bas-fonds après avoir goûté au luxe des quartiers chics. Ou encore, à la fin de Mulan, celle-ci retourne chez elle malgré la proposition de l’empereur de faire partie de son conseil.
Ainsi, les méchants ne sont pas ceux qui appartiennent à la classe dominée, mais ceux qui essaient d’en sortir. Ou plus exactement : ceux qui essaient d’en sortir en employant des moyens « condamnables ». Car l’ascension sociale est parfaitement autorisée dans l’univers Disney, mais sous certaines conditions. Le mieux est d’être choisi par un membre de la classe supérieure. C’est ce qui se passe dans la majorité des cas (par exemple pour Blanche-Neige, Cendrillon, Aladdin, ou encore Clochard dans La belle et le clochard, O’Malley dans Les Aristochats, ou Oliver dans Oliver et compagnie). Mais il est aussi possible d’y parvenir par ses propres moyens, à condition de travailler dur (comme Tania dans La princesse et la grenouille, qui est en même temps choisie par le Prince Naveen) ou de se distinguer par des exploits héroïques (comme O’Malley ou Clochard). Enfin, certains personnages peuvent aussi avoir tout simplement ça dans le sang, et ne faire partie de la classe dominée que par accident. Ceux-ci ne font alors que retrouver leur lieu naturel lorsqu’ils intègrent le monde des privilégiés (c’est le cas par exemple de Moustique dans Merlin l’enchanteur ou de Mowgli dans Le livre de la jungle). Notons que Belle mérite amplement son ascension sociale puisqu’elle cumule toutes ces conditions : au départ d’un naturel inadapté dans l’univers rural de son village, elle subit dans le château des épreuves qu’elle finit par surmonter, et la Bête la choisit finalement pour être sa femme.
En résumé, pour avoir le droit d’accéder à la classe supérieure chez Disney, il faut soit être élu-e, soit le mériter, soit avoir déjà ça dans le sang. Or les méchants ne remplissent aucune de ces trois conditions. Ils cherchent donc à obtenir une place qui ne leur revient pas de droit, et sont par là des êtres fondamentalement mauvais.
Si l’on reprend le cas de Gaston, celui-ci tente en effet de se hisser au-dessus de ses ploucs de congénères en convoitant la main de Belle. Or celle-ci vaut bien plus que cela, déjà princesse en puissance au début de l’histoire comme en témoigne son sentiment d’être comme une étrangère perdue au pays du peuple. Non, Gaston devrait se contenter d’une de ces blondes insipides et décérébrées qui lui tournent autour et de sa place de chef de pacotille d’un peuple d’indécrottables bouseux.
Beaucoup d’autres méchants chez Disney souffrent du même mal : ils veulent côtoyer les sommets de la hiérarchie sociale alors que leur imbécilité congénitale les condamne à rester en bas de l’échelle. C’est par exemple le cas d’Edgar dans Les Aristochats, des hyènes dans Le Roi lion, de Ratigan qui veut prendre la place de la Reine dans Basil, détective privé, ou encore de Jafar qui veut prendre celle du sultan dans Aladdin[3]. Les méchants de Pinocchio se caractérisent eux aussi par un désir de réussite facile. Grand Coquin s’habille comme un respectable aristocrate alors qu’il gagne son argent grâce à de minables larcins. Et Stromboli correspond à la figure de l’artiste qui gagne sa vie sans travailler, et que le film oppose à l’artisan consciencieux qui mérite son salaire (Geppetto).
Bridés, barbus, et vaudou dans le bayou
Mais cette caractérisation en termes de classe n’est pas la seule qui se substitue parfois au sexisme déterminant habituellement la représentation des méchants chez Disney. En effet, le studio a le bon goût de varier les plaisirs en nous offrant quelques portraits racistes bien sentis. Shan Yu, dans Mulan, en est peut-être le meilleur exemple. Si tous les personnages du film sont censés être asiatiques, l’écart est grand néanmoins entre le faciès des gentils et des méchants. Bizarrement, les gentil-le-s chinois-es ont le teint beaucoup plus rose que les méchants Huns, quant à eux pâles et « jaunissants ». La différence est flagrante si l’on compare par exemple Mulan à Shan Yu.
Dans le même ordre d’idées, les yeux des Huns sont beaucoup plus bridés que ceux des chinois. Il est ainsi facile de voir comment Disney occidentalise le faciès des gentils en même temps qu’il orientalise celui des méchants, pour mieux ramener ceux-ci à leur terre barbare d’origine.
On pourrait faire le même constat en ce qui concerne Aladdin, le visage de ce dernier étant plus proche de celui du Prince Eric de La Petite Sirène ou du John Smith de Pocahontas que de ses compatriotes barbus. Ces derniers réactivent quant à eux tous les stéréotypes occidentaux sur les « arabes », et ont bien sûr le monopole de l’accent de « là-bas »…
De même, dans La Princesse et la grenouille, le faciès du Dr Facilier se distingue nettement de celui du héros et de l’héroïne, qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à tous les couples hétérosexuels blancs qui ont fait les grands jours du studio. Par sa pratique du vaudou, ce méchant réactive la face sombre des stéréotypes occidentaux concernant les Noirs, alors que ceux associés aux gentils sont quand à eux beaucoup plus assimilables : Prince Naveen joue du jazz tandis que Tiana cuisine son gumbo et monte sa propre entreprise de restauration où elle accepte bien sûr de servir ses anciens maîtres blancs envers lesquels elle sait se montrer reconnaissante…
De Stromboli et son insupportable accent italien dans Pinocchio aux hyènes afro-américaine et latino du Roi Lion[4], cette galerie de personnages mobilise toujours le même racisme primaire voulant que les méchants sont nécessairement ces « Autres » de « là-bas » qui ne cherchent pas à s’intégrer (ou ne le peuvent même pas tellement ils sont arriérés), tandis que les héros et héroïnes reproduisent indéfiniment le même modèle occidental.
Paul Rigouste
[1] On peut remarquer aussi que lorsque le méchant est exceptionnellement quelqu’un de musclé, le studio renchérit systématiquement au niveau du physique du héros, d’une manière qui frise parfois le ridicule (cf. par exemple Tarzan, Hercule, ou La Belle et la Bête)
[2] On pourrait aussi se demander ce qu’il faut penser de la tendance de Disney à représenter les yeux de beaucoup de ses méchants maquillés (comme c’est le cas de Jafar, Ratcliffe, Rastigan, Clayton ou Stromboli) alors que ceux des héros ne le sont jamais.
[3] Hercule peut être aussi interprété selon ce schéma, avec l’opposition entre les hautes sphères de l’Olympe gouvernées par le gentil Zeus et les bas-fonds du royaume des morts où règne le méchant Hadès. Le mauvais goût de ce dernier est d’ailleurs manifeste lorsqu’il s’invite à la petite fête organisée par les dieux pour la naissance d’Hercule. Hadès n’est vraiment pas de ce monde…
[4] Ces accents renvoyant aux « minorités » états-uniennes ont disparu dans la version française, qui n’a conservé que l’argot caractérisant leur basse extraction sociale.

























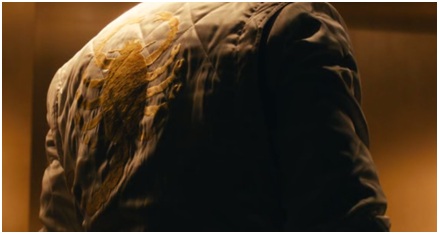







































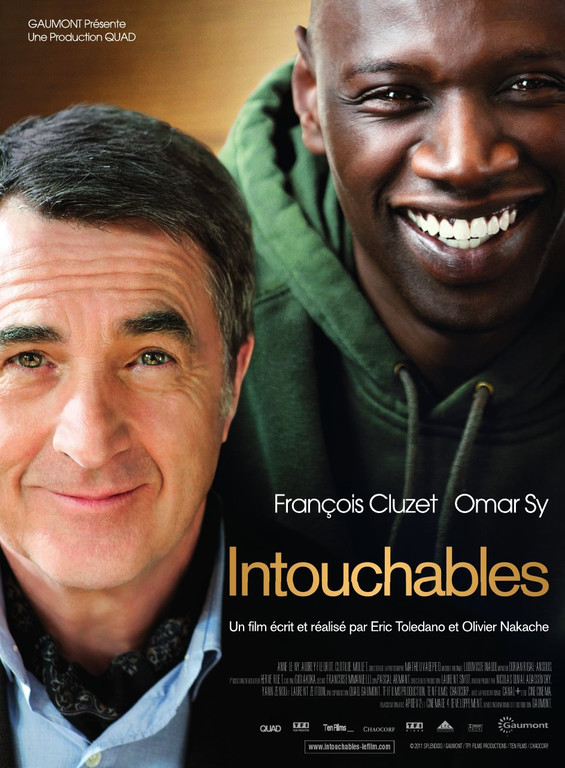
















Commentaires récents