Ces dernières années, le cinéma français a pu compter plusieurs films marquants racontant une histoire d’amour entre femmes. Certains long-métrages ont fait parler d’eux pour leur male gaze fort problématique (en première ligne desquels La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche), mais des réalisatrices telles que Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu, Naissance des pieuvres) et Catherine Corsini (La fracture, La belle saison) ont porté à l’écran des histoires qui tranchent avec l’hétéronormativité encore largement dominante dans les productions actuelles. Mais ils reproduisent souvent d’autres invisibilisation, de race et de classe notamment. Parce qu’un film peut difficilement répondre à lui tout seul aux attentes de tou-te-s les spectateurices et faire écho aux nombreuses perspectives diverses et intersectionnelles qui traversent nos vies, il existe donc encore et toujours un vrai besoin de multiplier les représentations en phase avec les réalités sociales, sans tomber dans des clichés réducteurs et discriminants, et bien sûr à l’abri de tout male gaze.
Avec son premier long-métrage intitulé « Les meilleures », Marion Desseigne Ravel apporte sa pierre à l’édifice en racontant l’histoire d’amour entre deux adolescentes, Nedjma et Zina, qui vivent dans un quartier populaire du nord-est parisien.
Je me suis entretenue avec elle à l’occasion de la sortie en salle de son premier long-métrage, prévue le 9 mars 2022.
Bande-annonce du film Les Meilleures
Tu filmes des jeunes femmes d’origine maghrébines dans un quartier populaire à Paris : en tant que scénariste et réalisatrice, comment as-tu travaillé ton regard pour écrire et pour réaliser ce film ?
Je l’ai travaillé de manière assez inconsciente. J’ai écrit ce film parce que j’ai travaillé pendant six ou sept ans environ en tant que bénévole dans une association de soutien scolaire, où j’ai fait face à des jeunes qui sont plus ou moins ceux qu’on voit dans le film : des adolescents, dont beaucoup de filles – parce que les filles viennent plus faire du soutien scolaire que les garçons -, et originaires majoritairement du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest. À cette époque, je ne pensais pas encore à faire un film, je faisais cette expérience à titre personnel. J’avais envie qu’il y ait un échange, donc les côtoyer m’a poussée à déconstruire pas mal de choses. Je suis arrivée avec mon lot d’a priori, avec mes idées reçues, et puis j’ai vu des ados face à moi qui avaient l’avantage de nous prendre à parti, moi et les autres adultes bénévoles, et de nous questionner. À 15, 16 ans, deux des ados ont commencé à porter le voile. Au moment où c’est arrivé, j’avais un a priori, peut-être une sorte de vision féministe universaliste qui dit que c’est la religion le problème. Sauf qu’en face de moi, c’était des ados que je connaissais déjà depuis trois, quatre ans, avec qui j’avais des liens assez chouettes et qui m’ont parlé, qui m’ont expliqué. J’ai travaillé autour de ces questions dans mon court-métrage, Fatiya. Dans le long-métrage, il y a cette scène où Nedjma discute avec une animatrice et lui dit : « mais est-ce que tu sortirais avec un babtou ? » C’est des trucs dont j’ai parlé avec les ados, ou plutôt dont eux ont parlé avec moi, parce qu’on parlait de sexualité et de sujets de société. Et c’est ce que j’ai essayé de retransmettre dans le film.
J’avais aussi conscience en écrivant qu’il y avait des points sur lesquels je serai toujours un peu en retard ou approximative. Notamment sur la langue des adolescents. Je savais que je ne pourrai qu’être dans une forme de copie. C’est pour ça que l’une des étapes de préparation du film a été de donner le texte aux comédiennes, d’en parler avec elles, et on a ré-inventé le vocabulaire ensemble.

Donc les comédiennes ont participé à l’écriture en quelque sorte ?
À l’écriture de la langue, en partie oui. Il y avait un scénario très écrit, dont les intentions étaient très précises. Je leur disais « dans telle scène, tu vas lui demander ceci, tu vas lui dire cela ». Mais on a discuté de comment ça allait être formulé : on a mis le dialogue en place ensemble. Il y a des répliques telles que « guette ta tête, frère » par exemple que je n’ai pas écrites, je n’en aurais pas été capable !
De la même manière sur le personnage de la mère, je me suis inspirée d’une personne que j’avais rencontrée. Toute la tirade sur le fait qu’elle cherchait la liberté en arrivant et France et qu’elle ne comprend pas la génération qui est face à elle, c’est quelque chose que j’ai entendu. Je ne fais pas un documentaire, mais j’ai essayé de m’inspirer de choses vécues, de ne pas être dans l’invention. Je n’ai pas le vécu de cette femme maghrébine et j’ai donc essayé d’être à l’écoute des personnes que j’ai pu rencontrer, de m’inspirer de témoignages que j’ai pu recueillir.
Il y a pas mal de films qui vont raconter des histoires d’amour entre femmes et dans lesquels il y a un male gaze qui est très présent, avec pas mal de clichés. Mais je n’ai pas retrouvé les mêmes types d’images et de sensations à l’écran dans ton film. Comment as-tu abordé la question ? Comment as-tu techniquement appréhendé la question de filmer deux jeunes femmes qui tombent amoureuses et qui ont des scènes érotiques ensemble ?
Il y a eu plein de facettes. Il n’y a pas une seule réponse à cette question.
Dans l’équipe technique, j’ai choisi de travailler avec une cheffe-opératrice, Lucile Mercier, que je connaissais déjà parce qu’on avait travaillé ensemble sur deux courts-métrages. Je savais qu’elle avait un regard profondément respectueux et bienveillant.
La deuxième chose, c’est qu’en tant que spectatrice adolescente, j’ai été sensible au male gaze (même si je ne connaissais pas ce mot quand j’étais jeune !). Je me souviens avoir vu certains films où il y avait des histoires d’amour et des scènes de sexe, hétéros pour la plupart, et avoir ressenti une forme de violence face à ces représentations-là. Et je me souviens de m’être dit : je ne veux absolument pas être à la place du personnage féminin qui me semblait terriblement passif, je n’ai pas envie de jouer ce rôle-là. Alors quand j’ai essayé de mettre en scène ces deux jeunes filles, je l’ai fait d’un point de vue où je me sentirais à l’aise.
Pour la scène de sexe… Je pense déjà que ce n’est pas important dans le film de les voir nues : l’histoire sera la même, cela ne va pas apporter quelque chose. Il y a certains films où cela pourrait apporter quelque chose de voir les corps nus, parce qu’il y aurait un sens. Mais pour mon film et ce que je voulais raconter, je ne pense pas qu’on en avait besoin. On a fait une réunion une après-midi avec Lina [El Arabi] et Esther [Rollande], les deux comédiennes. On s’est mis dans un bureau toutes les trois, on a pris la scène et on s’est dit « bon, qu’est-ce qu’on fait ? » J’ai fait des propositions : « alors moi j’aimerais bien faire ça, j’aimerais bien mettre la caméra là, j’aimerais bien qu’on fasse tel geste ». Et il y a des choses sur lesquelles elles m’ont dit non. Il y a des choses sur lesquelles elles m’ont dit oui et c’est ce qu’on voit dans le film.
J’ai essayé de faire en sorte qu’avant que l’on tourne, on soit toutes les trois en relation de dialogue, pour qu’elles se sentent à l’aise. Je crois qu’elles avaient confiance dans la façon dont j’allais les filmer parce que le processus était transparent.

Tu sais si c’est une démarche habituelle dans le cinéma en général ? On entend parler de scandales, d’actrices forcées de tourner des scènes alors qu’elles n’ont pas envie ou elles ne savent pas forcément comment elles vont être filmées. Dans l’approche que tu as eue, les actrices ont participé à la manière dont tu les as filmées, tu as recueilli leur consentement en fait,en les laissant libres d’accepter ou de refuser. Est-ce que tu penses que c’est quelque chose qui est habituel ?
Disons que c’est en train d’arriver très récemment. Je sais que depuis peu aux États-Unis, ils ont créé un poste de intimacy coordinator. C’est quelqu’un qui est censé coordonner les scènes de sexe et s’assurer – justement parce que ce n’est pas le réalisateur avec sa position de pouvoir – que tout le monde est consentant dans la scène de sexe qui va être tournée. C’est assez récent et aux États-Unis ils doivent être un petit peu en avance là-dessus. En France, depuis #MeToo, depuis ce qu’a pu dire Adèle Haenel, il y a aussi une conscience grandissante sur ces questions-là dans le cinéma.
Tu mets en scène une histoire d’amour, mais il y a aussi des histoires de violence. Pourquoi tu as choisi de représenter ce tandem ?
C’est-à-dire ?
Les relations violentes entre les filles rythment le film, que ce soit physiquement, que ce soit en tournant la vidéo pour piéger Zina. De la même manière il y a cette histoire d’amour et d’attirance incertaine, surtout de la part du personnage de Nedjma. Et moi ça m’a interrogée, car ça fait un peu un couple amour/haine. Pourquoi ne pas avoir fait qu’une histoire d’amour, par exemple ?
On voit plus souvent cet arc narratif pour les personnages d’hommes au cinéma : un petit dur, élevé dans des conditions difficiles, qui s’ouvre peu à peu à ses émotions et au sentiment amoureux. Le personnage de Nedjma est confronté à un milieu qui possède des codes violents et on la voit essayer de s’en libérer au contact de Zina qui, au contraire, refuse la violence quelle que soit la situation.
La deuxième partie de la réponse, c’est que dans mon désir de faire ce film, il y avait autant cette idée de filmer une histoire d’amour que l’envie de parler des réseaux sociaux, de la violence qui peut y régner et du poids de la réputation en ligne. Je voulais parler du fait qu’aujourd’hui c’est devenu central dans la vie de beaucoup d’adolescentes et qu’on a beaucoup trop d’exemples autour de nous de cas de harcèlement qui mènent à des drames. J’avais envie de raconter ça. Pour moi la violence sur les réseaux sociaux fait écho à la violence dans la vie quotidienne.

Ça me permet justement de rebondir sur ma prochaine question. Tes précédents court-métrages que j’ai vus ce sont deux huis clos, et en regardant le film j’ai eu l’impression d’être à nouveau dans un huis clos alors qu’on est à moitié en plein air, à moitié dans des appartements, sur le toit d’un immeuble. J’avais l’impression que les personnages étaient enfermés dans un environnement et ne pouvaient pas en sortir. Et du coup on arrive à cette conclusion où, pour qu’elles vivent leur histoire d’amour il faut qu’elles vivent un peu cachées – en tout cas c’est la conclusion un peu en suspens suggérée par le film, même si on peut s’attendre à d’autre chose après.
J’ai vraiment pensé l’espace du film comme étant l’espace clos d’un quartier qui vit sur lui-même. J’ai pu observer ce côté : on passe nos journées au square parce qu’on n’a pas forcément la possibilité de partir en vacances, on traîne dans les mêmes lieux toute la journée. C’est quelque chose qui était très prégnant. Et je crois effectivement que le film raconte cette tension entre une forme d’enfermement et le désir d’espace et de liberté des personnages.
Concernant la fin… je ne voulais pas que le film dise uniquement : « pour vivre heureuses, vivons cachées », ce qui pourrait être un peu plombant, voire défaitiste. Mais j’avais l’impression qu’au stade de leur vie où elles en étaient, les personnages pouvaient difficilement aller plus loin. Cela aurait été une forme de naïveté de ma part, je crois, d’imaginer que les choses allaient évoluer plus vite, plus facilement, et qu’elles allaient faire leur coming out à tout le monde, par exemple. Je pense que ce sont des choses qui prennent du temps. Quand Nedjma dit à Zina « oui, on va se cacher, parce que je n’ai pas la force d’aller dehors en public », elle lui dit aussi quelque part : « donne-moi du temps ».
Et puis on fait jamais « un » coming out : on en fait douze. Tu commences à le dire à une personne, puis une deuxième, et tu construis petit à petit ton espace safe, d’abord avec des ami-e-s, des allié-e-s. Et puis après tu le dis à tes parents. Le film se passe sur quelques jours, quelques semaines maximum, et il se passe beaucoup de choses en si peu de temps. Souvent à la fin, les spectateurs me demandent « mais pourquoi elle n’envoie pas tout péter ? ». Des fois j’ai envie de leur dire « mais à dix-sept ans, vous l’auriez fait ? » C’est difficile. Je me rends bien compte qu’on aurait envie que cette histoire d’amour finisse mieux, de manière plus franchement optimiste. Mais je voulais que cela reste réaliste vis-à-vis de mes personnages.
Il y a ce dernier regard plein de défi, à la fin du film, qui vient contredire tout ce que Nedjma a pu dire avant.
Oui. Quand elle traverse le local à la fin, en fait tout le monde est au courant. C’est un jeu de dupes.
J’aimerais bien revenir sur les représentations des féminités que tu as porté à l’écran. Je ne sais pas si c’était voulu ou pas, mais il y a un petit peu une dynamique butch-fem.
Je pense que ce sont des mots qui n’appartiennent pas du tout à l’univers des personnages. Par rapport aux ados telles que je les connais, il y a un côté – c’est hyper simplificateur ce que je vais dire -, mais il y a soit des filles hyper sexualisées qu’on appelle les « crasseuses » et qui vont être pointées du doigt pour être « trop » féminines, pour « montrer » trop de choses. Et puis les filles qui au contraire vont avoir peur de ça ou ne veulent pas de ça, et qui vont s’habiller en jogging et qui vont être plus discrètes sur leur sexualité. Pour moi il y a de la violence dans les deux cas, on leur donne juste deux choix : soit tu mets un jogging, soit tu mets une mini-jupe et puis selon tu vas être considérée comme ceci, comme cela. Ça m’intéressait effectivement de dialoguer avec ces deux rapports à la féminité.

Tu as fait des avant-premières, quelle a été la réception du public jusqu’à présent ? Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont marquées ?
Oui, il y a plein de choses qui m’ont marquée. Déjà, on a eu la chance d’avoir dans le public plusieurs personnes très concernées par le film, qui pouvaient être dans des situations assez analogues à celles des personnages. Des femmes de cité, maghrébines, qui ont pris la parole et dit que le film était respectueux. Je me souviens d’un jeune homme noir qui a pris la parole au festival Ciné-banlieue à Saint-Denis qui a dit « merci de nous avoir respectés à travers ce film ». Pour moi, c’était en quelque sorte le graal par rapport à comment je voulais représenter ces ados.
Surtout que le film va dans la violence, comme on en parlé tout à l’heure, et que c’était important pour moi d’essayer de trouver un équilibre où je ne veux pas les réduire à cette violence-là mais je ne veux pas non plus faire l’impasse dessus. Comment est-ce qu’on peut faire pour raconter qu’ils ne sont pas que ça, que c’est plus complexe, qu’il y a autre chose ? C’est pour ça que la cousine est l’un des mes personnages préférés, car c’est peut-être la plus violente au départ, mais c’est aussi la plus compréhensive par la suite.
C’est l’adulte aussi, quelque part.
Les actes les plus marquants dans le film sont souvent le fait des personnages les plus jeunes. Je pense aux mots de la petite soeur qui dit que l’homosexualité est une « maladie ». À l’inverse, le personnage de Yousra, la cousine, a une plus grand maturité qui lui fait accepter la « différence » de sa cousine.
Elle encourage Nedjma d’ailleurs.
La première fois que j’ai rencontré Laetitia Kerfa, la comédienne qui joue Yousra, on a pris un café et j’ai commencé à lui raconter le scénario. A un moment, elle m’a dit : « Marion arrête toi, stop. Je te préviens, moi je ne jouerai pas le rôle d’une homophobe. Je ne veux pas aller faire du cinéma pour ça. » Et je lui ai dit « écoute, ça tombe bien, a priori tu es le personnage le plus compréhensif de tous ».
A l’inverse, les personnages les plus durs c’est peut-être Samar et Yasmine (jouées respectivement par Mahia Zrouki et Tasnim Jamlaoui). Ce sont des comédiennes avaient qui j’avais déjà tourné un court-métrage. On avait une relation de confiance : pour moi c’était important de leur demander à elles, avec qui j’avais une relation de longue date, de jouer les personnages les plus violents du film, parce qu’on allait travailler ensemble le fait de ne pas les stigmatiser pour autant. J’espérais qu’on pourrait apporter une sorte de nuance à ces personnages-là, même si leurs actes sont condamnables.
Pour revenir à la réception du film, l’autre retour qui m’a beaucoup touchée, ce sont ceux de spectateurs plus âgés, qui me disent que pendant les quinze, vingt premières minutes, ils n’ont pas réussi à rentrer dans le film, que les codes de ces adolescents leur sont trop étrangers… Mais qu’au cours du film, ils ont été rattrapés par les personnages, ils ont été émus par eux et à la fin ils ont réussi à partager des émotions avec ces ados. Et ça je trouve ça super cool de me dire que je n’ai pas fait un film qui ne parle qu’à un seul type de public déjà convaincu. Que le cinéma peut créer une forme de dialogue.
Aujourd’hui, est-ce que c’est difficile de faire ce genre de films en France ?
Sincèrement, je ne sais pas. Aujourd’hui, c’est très difficile de faire un premier long-métrage en France. Autour de moi j’ai plein d’ami-e-s réalisateurices qui font, qui ont fait ou qui sont en train de faire un premier film, et à part quelques exceptions où ça se passe bien parce que les planètes sont alignées, c’est galère de faire un film. Oui, ça a été long, ça a été difficile, mais je ne sais pas si ça a été à cause du sujet.
Quels sont tes prochains projets ?
J’ai plein d’envie et de projets. Ce qui serait peut-être mon prochain long métrage, c’est encore autour de thématiques LGBT et ça raconte une histoire de famille qui s’est déchirée, où il y a eu des conflits et c’est une histoire de réconciliation. Ça se passe dans un lieu très différent, mais toujours autour de questions de définitions identitaires qui sont importantes pour moi. Et puis j’ai un projet de série co-écrite avec un autre auteur autour de la question de la place de l’Islam en France, qui est une question que j’ai envie de creuser. Pas du tout avec un point de vue, disons, de l’intérieur car je ne suis pas de confession musulmane, mais ce qui m’intéresse de voir c’est pourquoi aujourd’hui en France, cette religion suscite autant de débats et de réactions, parfois très virulentes.



















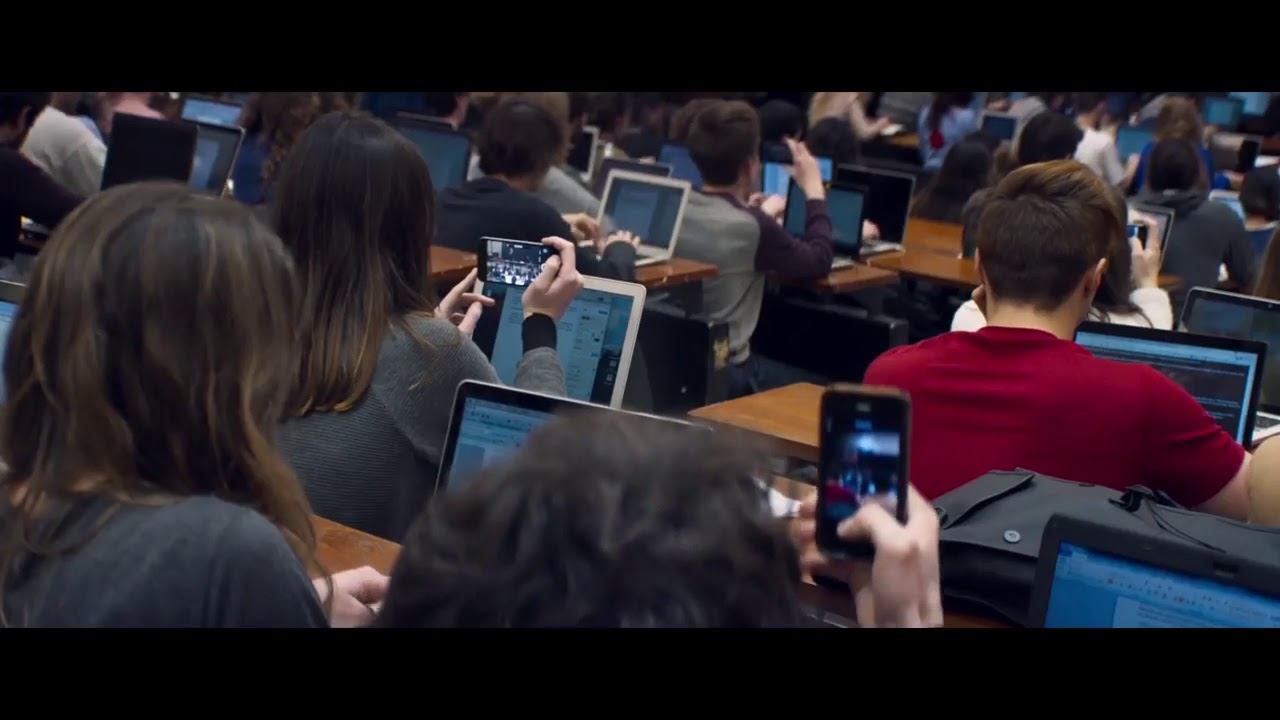

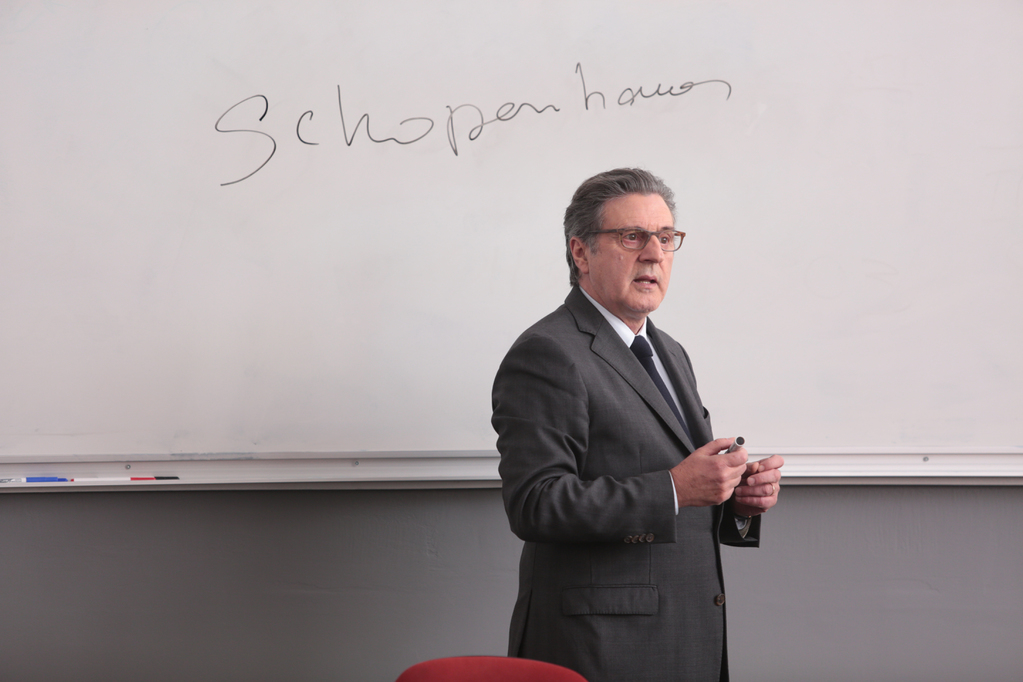

































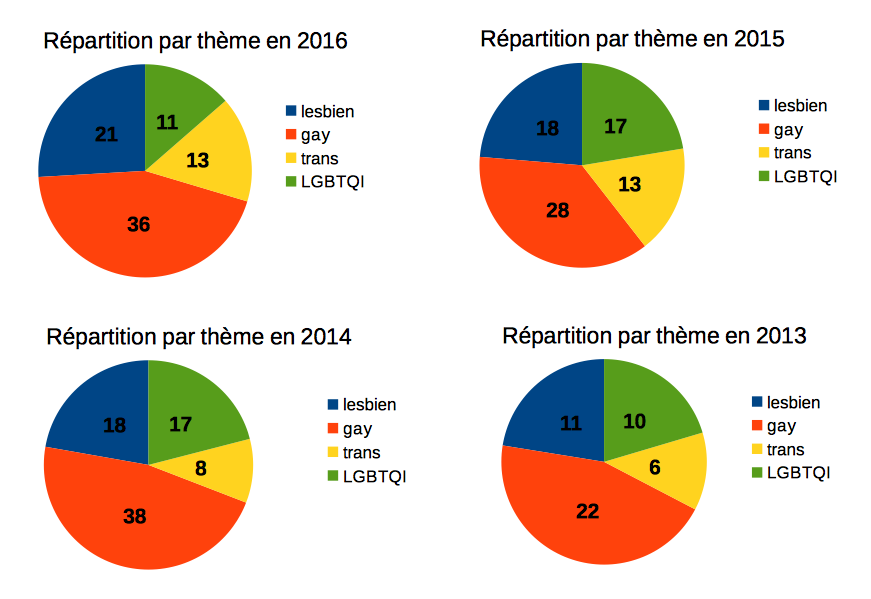
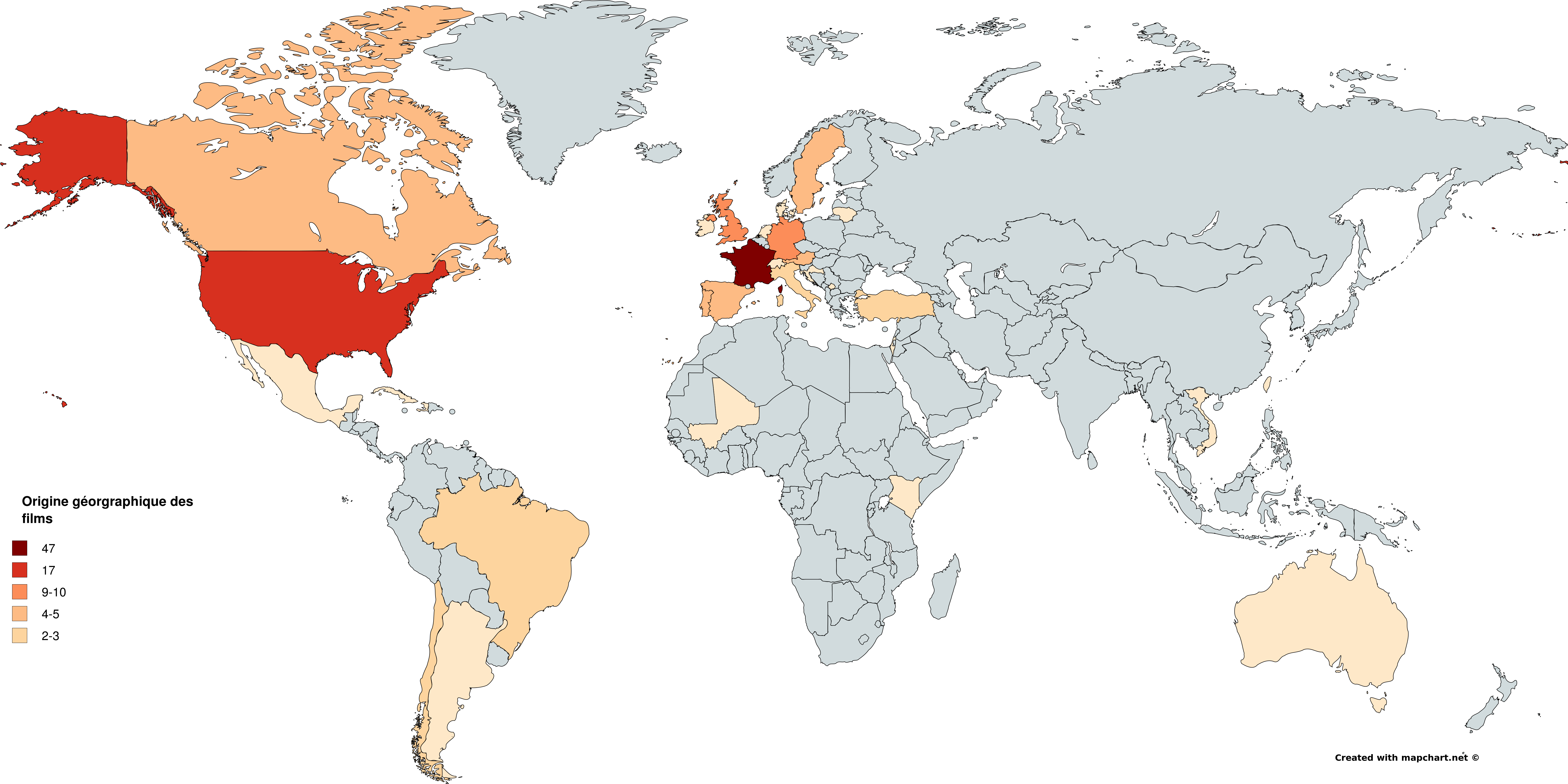

























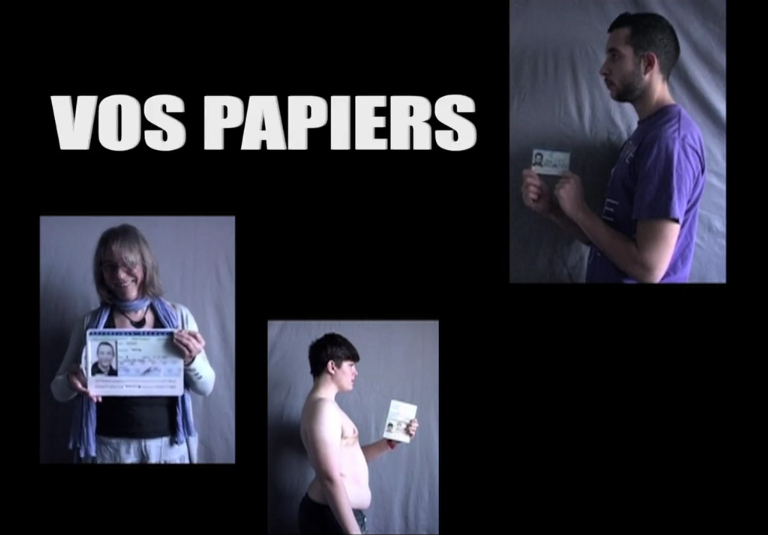


























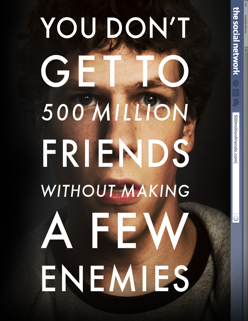

















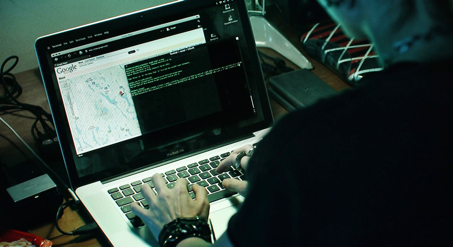
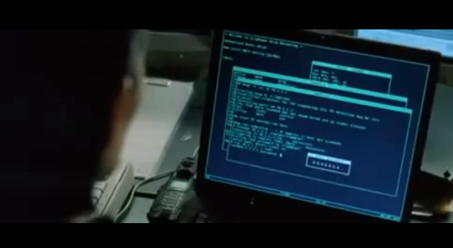





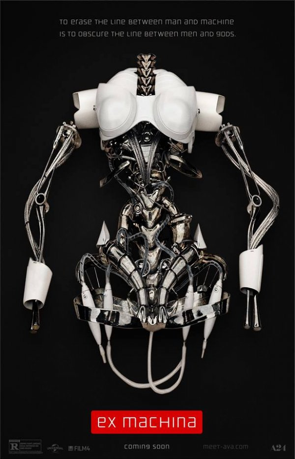

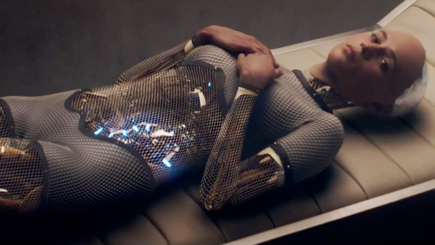
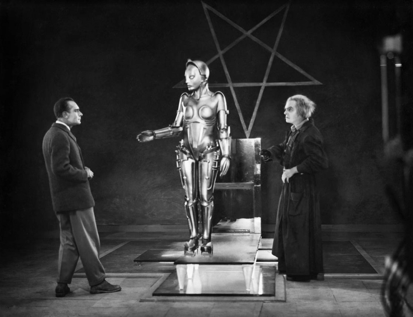











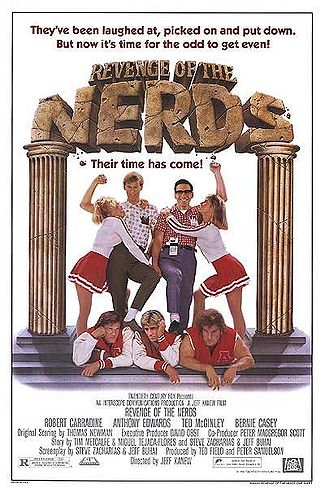
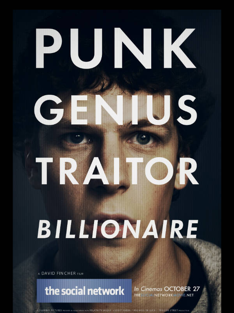










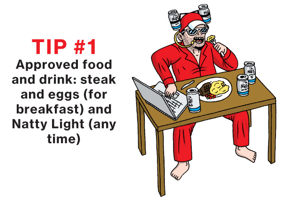



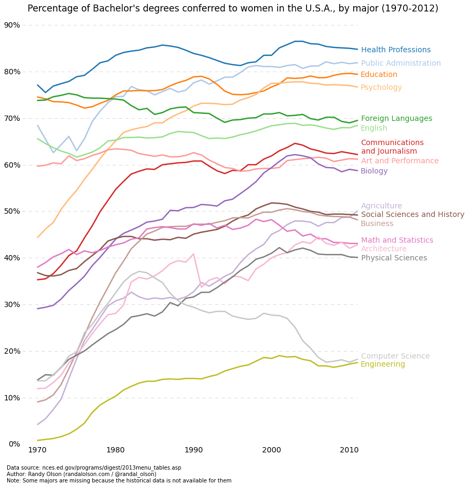



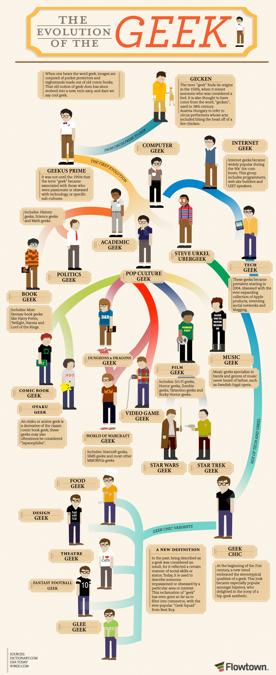




Commentaires récents